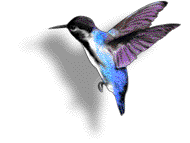IF à la vie, ELSE à la mort !
Taxus baccata L.
![]()

Lors de vos pérégrinations en Normandie, il ne sera pas surprenant que vous tombiez sur un If, l’arbre des cimetières. Majestueux, il vous protégera de son ombre dense. Ses feuilles sont disposées sur un même plan de part et d’autre du rameau, mais contrairement au sapin argenté elles sont molles et vert-clair au-dessous.
Son houppier est très rameux et généralement de forme pyramidale, comme l'ustensile du même nom (if) en forme de cône hérissé de pointes qui sert à égoutter les bouteilles ou sur lequel on dispose les cierges dans une église.
Parfois, on a des formes à port fastigié qui correspondent à une variété appelée l’If d’Irlande ; mais, le plus souvent, l’arbre présente des formes diverses qui sont le témoignage de tailles sévères, de branches cassées par de violents orages ou de coups de foudre subis au cours de plusieurs milliers d’années. Et oui, il existe encore d’illustres spécimens, comme « the Canada yew » du cimetière de Fortingall à Perth and Kinross en Écosse, il est âgé, parait-il, de 5 000 ans !
A côté, l'If commun du cimetière d'Estry dans le calvados, âgé seulement de 1 600 ans, est un petit jeunot qui était quand même présent avant l’église, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Arbre de vie (il est toujours vert) et de mort (il est très anciennement connu comme poison), lors des rites païens, l'If était souvent planté sur les tombes elles mêmes, les racines puisant l’âme du défunt dans les corps ensevelis pour l’amener vers les branches les plus élevées et vers l'au-delà. Lors de la christianisation, ces lieux de cultes furent recyclés pour construire les églises avec leur cimetière tout en gardant l’If et sa symbolique... Cette métaphore explique pourquoi il symbolise la tristesse et le chagrin dans le langage des fleurs. Plus iconoclaste, était le barbier dénommé Gosselin, qui, en 1820, eut l'heureuse idée d'établir chaque dimanche, pendant la messe, ses rasoirs et son plat à barbe dans le tronc creux d’un des ifs de Lande-Patry, dans l'Orne, tandis que 21 clients pouvaient attendre à l’abri dans l’autre if creux.
Très présent dans une grande partie de l’Europe depuis le Trias (- 200 millions d’années), sa présence a fortement diminué de nos jours. En dépit de sa grande tolérance à l'ombrage, sa croissance très lente, sa surexploitation et sa mauvaise réputation liée à sa toxicité, rendent la régénération naturelle de l’If européen de plus en plus difficile, conduisant à un appauvrissement de la diversité génétique des petites populations d'ifs résiduelles. De nos jours, l’ If des haies doit son salut à son utilisation comme arbre d’ornement, apte à la taille en topiaire ou en haie séparative, et à son statut de protection dans plusieurs pays.
Donc, son principal ennemi est l’homme, mais il lui rend bien. Écorce, graines, et feuilles sont extrêmement toxiques, même après la dessiccation ou la cuisson. Les chevaux y sont très sensibles, mais aussi les vaches, moutons, porcs, chiens, et volailles. De nombreux chevaux de corbillard ont ainsi été victimes d’« intoxication du cheval de corbillard », en consommant l’If à l’entrée du cimetière par ennui pendant les cérémonies. Aussi, il ne peut être planté près des pâturages et a fait l’objet d’ostracisme dans les régions d’élevage.
Il est aussi toxique pour l’homme. La preuve, dans Hamlet de Shakespeare, le roi du Danemark est mort après avoir absorbé une boisson agrémentée aux extraits d’If ! S’il est rare que l’on se mette à manger comme un cheval des branches d’If à baies, l’arille (le fruit), constituée d’un tissu mucilagineux rouge vif attractif, est la seule partie comestible. Elle était consommée autrefois en confiture ou en sirop pectoral. Toutefois, il ne faut surtout pas mordre dans la graine qui est mortelle. Le plus sage est d’interdire formellement aux enfants goulus d’en manger ; ils peuvent éventuellement en donner à leurs lapins ou chats domestiques qui semblent insensibles au poison. Les Grives et les Sitelles en sont friandes ; elles rejettent la graine dans leurs excréments, ce qui contribue à la dispersion de l’espèce.
L’If récurvé contient des alcaloïdes neurotoxiques et cardiotoxiques (taxine) proche du curare, qui fut utilisé par les Gaulois, pour enduire l'extrémité de leurs flèches au moment de partir à la chasse ou à la guerre. Ils l’appelaient Ivos, ce qui est à rapprocher du terme d'ivaie pour les forêts d'ifs. J.K. Rowling a du plagier cette pratique dans la saga Harry Potter, car la baguette originelle de Voldemort est en bois d'If. Quant au chimiste Pierre Potier, il peut lui aussi être considéré comme un magicien car il a réussi à synthétiser, à partir d'une substance voisine extraite du feuillage de l'If européen, le taxotère, un homologue plus puissant que le taxol lui même produit à partir d’une autre espèce l’If du Pacifique. Ce produit est injecté par intraveineuse pour bloquer les divisions cellulaires tumorales notamment dans les cas de cancers du poumon, du sein ou de l’ovaire.
Le bois d’If commun est rouge, inodore, imputrescible, ce qui, avec ses qualités de résistance, lui confère une grande durée de vie, voire l’immortalité puisqu’on l'a retrouvé pour fabriquer des sarcophages égyptiens, sans pour autant être présent dans ces contrées. Il est également très recherché en marqueterie, coloré, il se confond avec l’ébène mais à moindre coût. Sa belle teinte orangée-rougeâtre, fait qu’il est très prisé des ébénistes et luthiers car il a aussi des qualités acoustiques exceptionnelles. Enfin, rappelons que c'est grâce à leurs arcs en bois d’ If, « les longbow », que les archers anglais ont terrassé la cavalerie française à Crécy, puis Azincourt ! Pour conclure, si « IF » est une instruction conditionnelle en programmation informatique, « If » est aussi le nom de l’îlot où sera enfermé de Dantès pendant 14 ans dans le roman du Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas !